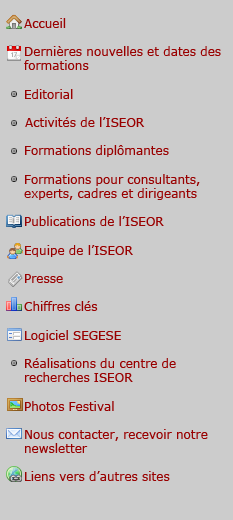ARTICLE 1
Une tautologie peut-elle générer une théorie fertile ?
Les leçons de l’évolution de la théorie RBV
Résumé :
Les tautologies sont généralement condamnées au plan
scientifique. Cet article discute le bien fondé de ce phénomène, du fait
de l’existence d’au moins trois types de tautologies, dont les faiblesses
relatives doivent être nuancées. L’article démontre également qu’il est
nécessaire de moduler les critiques en fonction de « l’approche » de
recherche mobilisée.
La démonstration s’effectue en prenant pour cadre d’analyse les
travaux en stratégie consacrés à la « théorie RBV ». En effet, cette
théorie a subi des critiques virulentes à l’origine. Mais, à la suite de
modifications visant à rendre les critiques obsolètes, la théorie RBV a
conquis le statut de théorie « détautologisée »...
par Jacques Liouville
Professeur de sciences de gestion
Ecole de Management Strasbourg
CESAG – EA 1347
Université de Strasbourg |
ARTICLE 2
Logique et ingénierie théorique en
stratégie d’entreprise
Résumé :
NLa stratégie et l’entreprise peuvent être appréhendées au travers
d’une ingénierie qui construit les solutions possibles et imaginables
pour répondre à la question du changement qui affecte l’entité. Il
s’ensuit une logique spécifique qui lie la pensée et l’action en la
matière. Ingénierie et logique ne sont pourtant pas du seul fait de la
population et des moyens intrinsèques à l’entreprise, ni même du
stratège-manager qui la dirige. Les décisions, conceptions et actions
stratégiques ne relèvent pas d’une discipline idéale pour gérer
l’entreprise. En revanche, la stratégie apparaît comme enracinée dans
la nature même de l’être humain car elle ressortit d’un ancrage social
qui permet d’aller plus loin dans la connaissance de la strategie.
par Maria Zerizer
Docteur d’Etat en sciences politiques spécialisé en stratégie
Université de Paris I Panthéon Sorbonne
Professeur d’enseignement supérieur
Ecole Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA- Alger) |
ARTICLE 3
Pour une approche organisationnelle de la gestion des
risques opérationnels dans les institutions de
microfinance
Résumé :
L’approche réglementaire proposée par le comité de Bâle, centrée
sur la mesure et la valorisation du risque opérationnel, si elle est en
adéquation avec le secteur bancaire, semble inadéquate pour les
institutions de microfinance (IMF). D’où la nécessité de proposer une
grille conceptuelle d’analyse du risque opérationnel dans les IMF.
L’architecture organisationnelle et la littérature sur les formes
d’intégration des IMF permettent de considérer le risque opérationnel
comme la conséquence des comportements déviants. Il subit
l’influence des contingences organisationnelles et institutionnelles des
IMF.
par Hubert Tchakoute Tchuigoua1
Professeur associé
Groupe ESC Troyes |
ARTICLE 4
Les freins culturels à l’adoption des IFRS :
une analyse du cas français
Résumé :
Une étude européenne du cabinet français Mazars de 2005 a
montré que la France est le pays qui a le plus résisté à l’adoption des
normes comptables internationales IAS/IFRS. Tout en dépassant les
différences techniques qui existent entre les IFRS et le référentiel
français et qui sont valables pour d’autres pays comme l’Espagne,
l’Italie ou l’Allemagne (pays qui n’ont pas montré de fortes
résistances), cet article tente de mettre en lumière d’éventuelles
spécificités culturelles françaises sous-jacentes à cette résistance. Les
résultats tirés de dix entretiens semi-directifs effectués avec des
experts comptables, des auditeurs et des universitaires en France
seront exposés. Ces résultats montrent que des variables comme la
langue, la religion, l’organisation sociale ou encore la politique
peuvent apporter des éléments de réponses supplémentaires à la
résistance française aux normes internationales.
par Samir Ayoub
Professeur
Groupe ESSCA (Ecole Supérieure des
Sciences Commerciales d’Angers)
(France)
Keith Hooper
Professeur
Faculty of Business; Auckland University of Technology
(Nouvelle-Zélande) |
ARTICLE 5
Les revues coopératives :
de l’horizon rêvée à l’horizon revisitée
1840-1940
Résumé :
La trajectoire historique des revues gestionnaires critiques
commence en 1840 avec la naissance de l’atelier dans un contexte
socio politique particulier. Cette aventure se prolongera
idéologiquement dans la mouvance socialiste par la réforme
économique et dans les valeurs de l’économie sociale par
l’émancipation de l’école de Nîmes et la revue des études
coopératives.
par Robert Noumen
Maître de conférences à l’Université d’Orléans
CEPN – CNRS (FRE 3256) |
|