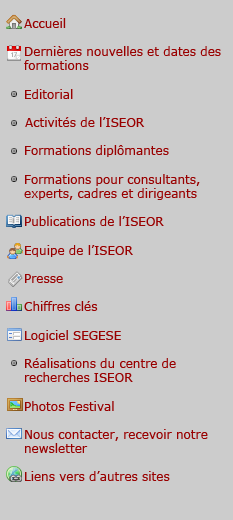ARTICLE 1
La pertinence du choix de la filiale à l’étranger
comme forme organisationnelle d’investissement en
R&D par les firmes multinationales
Résumé :
Parmi les formes d’internationalisation des activités de R&D, les
multinationales peuvent opter pour la localisation de ces activités au
sein de leurs filiales à part entière. Si ce choix peut procurer de
nombreux avantages, liés notamment à l’internalisation des fonctions
stratégiques, il suscite des interrogations d’ordre organisationnel. La
décentralisation de la R&D peut accentuer les divergences entre les
intérêts de la maison-mère et les responsables nommés à la tête de ces
filiales. Des mécanismes particuliers de contrôle et d’incitation
devraient être mis en place pour réussir cette forme de gouvernance.
par Dhikra Chebbi Nekhili
Maître de Conférences à l’Université du Maine
Mehdi Nekhili
Maître de Conférences à l’Université de Reims
Professeur affilié à Rouen Business School |
ARTICLE 2
Les entreprises des pays émergents, nouveaux acteurs
de la mondialisation : cas d’une opération de fusionacquisition
de type « entreprise émergente acquéreuse –
entreprise développée cible »
Résumé :
Depuis la vague de libéralisation financière qui a touché les
marchés émergents dans les années 90, ces derniers sont entrés dans
un processus continu d’intégration au marché mondial, processus
soutenu à la fois par une épargne abondante et des marchés
financiers en plein essor. L’année 2000 marque une nouvelle étape,
avec la multiplication des « fusions-acquisitions » de type « Sud-
Nord ». Le cas de la fusion entre Tata Steel et Corus analysé dans
cette étude met en évidence d’une part l’évolution de la configuration
et du mode de financement des opérations, et d’autre part leur
principale motivation plus axée sur l’acquisition de compétences.
par Joëlle Randriamiarana
Enseignant-Chercheur
Groupe ESC Clermont |
ARTICLE 3
Les déterminants de l’erreur de prévision
des analystes financiers : application au cas des analystes financiers français
Résumé :
Nous étudions les déterminants de l’erreur de prévision des
analystes financiers français. Nous montrons que l’erreur de
prévision diminue avec la fréquence des révisions ainsi qu’avec
l’importance des moyens mis à la disposition de l’analyste, mesurés
par la taille du bureau employeur. Nous ne trouvons pas d’effet de
l’expérience de l’analyste, ni de son degré de diversification sur le
niveau de précision de ses prévisions.
par Salma Tebourbi Meddeb
Docteur en Sciences de Gestion
Institut de recherche en gestion
Université Paris 12 - Val de Marne |
ARTICLE 4
Contrôle institutionnel et
valorisation des résultats comptables
Résumé :
Récemment, le contrôle que peuvent exercer les investisseurs
institutionnels sur les sociétés a suscité l’intérêt aussi bien des
chercheurs que des professionnels de la scène financière. Cette étude
a pour objectif d’examiner l’influence du contrôle institutionnel sur la
valorisation des résultats comptables par le marché boursier français.
Les résultats de notre analyse montrent que, lorsque les investisseurs
institutionnels détiennent une proportion significative du capital, ils
exercent un contrôle actif et augmentent le pouvoir informatif des
résultats comptables.
par Ramzi Benkraiem
Professeur Assistant de comptabilité financière
GSCM – Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier |
ARTICLE 5
Le rôle de la personnalité dans les situations de
coopétition : le cas des futurs managers
Résumé :
La coopétition est étudiée essentiellement sous le prisme des
relations inter-organisationnelles. Or, celles-ci sont tissées sur la base
de relations individuelles. Cette contribution vise à combler le
manque théorique relatif à la coopétition interindividuelle.
S’appuyant sur un échantillon de 165 futurs managers actuellement
en apprentissage, cet article dresse une typologie des acteurs en
fonction de cinq dimensions inhérentes à la coopétition. En découlent
trois profils : les compétiteurs, les coopérateurs et les coopétiteurs. Il
est montré que les traits de personnalité des acteurs expliquent les
cinq dimensions de la coopétition mais que ces relations sont
différentes en fonction des trois profils de manager.
par Mickaël Géraudel
Professeur Assistant
Groupe Sup de Co Montpellier - CEROM
David Salvetat
Professeur Associé
Groupe Sup de Co La Rochelle - CEREGE |
|