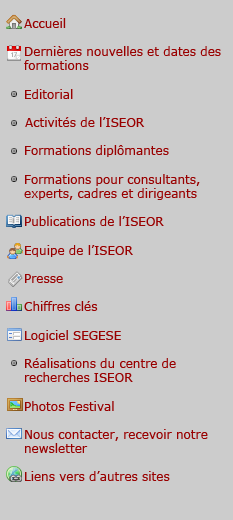RÉSUMÉS du Numéro 64 - Abonnement 2009 - FRANCAIS
|
Revue "Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión" - ISBN 2259-6372 |
| Chaque article a des résumés en français, anglais et espagnol |
ARTICLE 1
Décision, expérience et valeur de consommation -
esquisse d'un nouveau cadre théorique
pour l'analyse du comportement du consommateur
Résumé :
Cet article propose d'analyser la place que le concept de valeur
peut occuper dans un modèle général du comportement du
consommateur. Ce concept peut en effet permettre de relier des cadres
théoriques traditionnellement disjoints : la prise de décision par
traitement d'informations et par recherche d'expérience, l'analyse
transactionnelle et l'analyse relationnelle de l'interaction entre
l'individu et le produit ou service.
par Marc Filser
Professeur des Universités
IAE Dijon et Cermab-LEG
Université de Bourgogne
(France) |
ARTICLE 2
De la valeur client à la valeur amont - management de l’exploration et analyse de valeur
Résumé :
Cet article s’intéresse à la détermination de la valeur dans les
processus d’exploration. Comment valoriser ce qui n’existe pas
encore ? Comment déterminer la valeur en amont des filières et des
marchés ? La première partie souligne les limites des approches de la
valeur client pour répondre à la problématique de l’exploration tandis
que la seconde s’attache à définir un nouveau cadre de la « valeur
amont ». L’enjeu de l’exploration de la valeur est la transformation
des conditions d’activité de destinataires afin de produire de
nouveaux « effets utiles » pour ces destinataires.
par Gilles Garel
Professeur des Universités
Université Paris Est, OEP Prism, Paris
(France)
Rodolphe Rosier
Algoé, Paris
(France) |
ARTICLE 3
Le concept de coût-valeur des activités.
Contribution de la théorie socio-économique des organisations
Résumé :
Cet article présente le concept de coût-valeur des activités qui
situe l’analyse de la création de valeur depuis l’entreprise jusqu’au
niveau macro-économique. L’enjeu est de développer des stratégies
de création de valeur d’entreprises et de répartition de cette valeur
entre les parties prenantes internes et externes de l’entreprise, par
opposition aux stratégies dominantes de réduction des coûts.
Après la présentation du concept, la deuxième partie porte sur ses
applications relatives aux indicateurs d’analyse de gestion et
d’analyse du coût-valeur des activités stratégiques et opérationnelles
de l’entreprise et présente des résultats sur la rentabilité élevée des
investissements incorporels centrés sur le développement du potentiel
humain.
par Henri Savall
Professeur des Universités
IAE, Université Jean Moulin Lyon 3 - ISEOR (*)
(France)
Véronique Zardet
Professeur des Universités
IAE, Université Jean Moulin Lyon 3 – ISEOR(*)
(France) |
ARTICLE 4
Juste valeur et globalisation comptable - questions autour du processus de normalisation comptable internationale
Résumé :
La mondialisation financière a provoqué un fort mouvement de
globalisation comptable caractérisé par la montée en puissance des
normes IFRS et par une accélération du processus de convergence
entre le référentiel IFRS et les normes américaines sous l’impulsion
de la Securities and Exchange Commission. Ce « socle comptable
global » cherche à répondre aux besoins des investisseurs et des
marchés financiers. Il accentue fortement la financiarisation du
modèle comptable par l’introduction de la juste valeur et une nouvelle
conception de la performance. Cette évolution pourrait poser un
problème de légitimité politique et de gouvernance de cette régulation
comptable.
par Robert Teller
Professeur des Universités
Université Nice Sophia Antipolis
IAE - GREMAN
(France) |
ARTICLE 5
Les « valeurs culturelles » en gestion : objet d’analyse à construire ou levier de manipulation idéologique ?
Résumé :
Après la déferlante de la « culture d’entreprise » des années 1980,
la gestion est passée depuis la fin des années 1990 au « management
interculturel » ou au « management par les valeurs ». Les pistes
esquissées dans ce court texte visent à évaluer les possibilités de faire
du concept de « valeurs » un outil d’analyse ou d’y voir un levier de
manipulation.
par Eric Godelier*
Professeur des Universités
Professeur École Polytechnique, (CRG) Paris
(France) |
ARTICLE 6
Coopétition et performances -
le cas du football professionnel français
Résumé :
Dans des recherches récentes, il est considéré que les entreprises
ont intérêt, pour être performantes, à adopter des stratégies de
coopétition. Ces stratégies leurs permettraient de bénéficier
simultanément des avantages de la compétition et des avantages de la
coopération. Cette proposition reste toutefois à confirmer plus
largement. L’objectif de cette recherche est donc de tester l’hypothèse
de supériorité de la stratégie de coopétition sur les stratégies de
compétition et sur les stratégies de coopération. Le terrain de
recherche est le football professionnel français. Les résultats obtenus
montrent l’existence de comportements coopétitifs au sein du secteur.
Ils montrent également l’existence d’une relation entre le
comportement coopétitif des clubs et leurs performances économicosportives
ainsi qu’avec leurs performances financières.
par Frédéric Le Roy
Professeur des Universités
Université Montpellier I, ERFI-ISEM
et Groupe Sup de Co Montpellier (France)
Pierre Marques
Université Montpellier I, ERFI-ISEM
et Groupe Sup de Co Montpellier (France)
Frank Robert
Professeur
Groupe Sup de Co Montpellier
Montpellier Business School (France) |
ARTICLE 7
Valeur « qui a un prix » vs. valeur « qui n’a pas de prix », un débat de société
Résumé :
La valeur est un concept très ancien qui donne un sens à l’action
et apparaît comme le fondement d’un jugement d’appréciation,
individuel ou collectif, des acteurs concernés et des résultats de leurs
initiatives. On peut donc dire que la conception de la valeur qui est
véhiculée dans la Société, contribue à modeler l’évolution de celle-ci.
Mais il apparaît que la définition-même de la valeur est fortement
controversée et sa mesure souvent contestable. Il en résulte des
orientations sociétales elles aussi contestables, voire inquiétantes au
regard d’un développement que d’aucuns souhaitent « humain ».
Comment cela ?
par Sabine Urban
Professeure Émérite
Université Robert-Schuman, Strasbourg
(France)
(España) |
ARTICLE 8
Valeurs et responsabilités - l’entrepreneur français, entre compétitivité et légitimité
Résumé :
L’évolution de l’entrepreneur français au cours de la gestation,
puis du développement du capitalisme industriel est représentative de
l’ambivalence des relations entre les « valeurs » et les
« responsabilités » économiques, d’une part, et sociales, d’autre part.
La question se ramène aux principes de compétitivité et de légitimité.
La faible légitimité de départ sera compensée et réhabilitée avec la
montée de la bourgeoisie industrielle et la figure du patron. La
seconde vague d’industrialisation met au premier plan le manager,
substitut du patron, nonobstant la montée en légitimité de « nouveaux
entrepreneurs ». La troisième vague fait surgir de nouvelles valeurs,
induisant de nouvelles responsabilités, en relation avec de nouvelles
bases de compétitivité, autour des réseaux de petites entreprises
individualisées.
par Michel Marchesnay
Professeur Émérite
Université de Montpellier 1, ERFI
(France) |
ARTICLE 9
La responsabilité sociétale d’entreprise - portraits croisés de deux entrepreneurs
Résumé :
Ce papier propose d’analyser la Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) au travers des portraits croisés de deux
entrepreneurs d’une même région à trois décennies d’intervalle.
Autodidacte, l’entrepreneur A a fondé son entreprise en 1976 dans le
secteur des services aux industriels. Diplômée, l’entrepreneur B a
créé son entreprise en 2007 dans le secteur de la mode. Leur point
commun est la conviction que le monde de l’entreprise se doit d’être
responsable vis-à-vis de la Société, au sens large du terme, ce qui se
traduit par un engagement fort tant sur le plan environnemental que
sur celui du social. Ces deux itinéraires illustrent que la RSE n’est pas
un phénomène de mode, mais davantage une affaire de conviction et
de bon sens des entrepreneurs.
par Robert Paturel
Professeur des Universités
IAE, Toulon
Université du Sud Toulon Var (France)
Sandrine Berger-Douce
Maître de Conférences
IAE, Valenciennes
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France) |
ARTICLE 10
La responsabilité sociale de l’entreprise comme thème de gestion ?
Résumé :
La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est devenue
aujourd’hui un thème de gestion après la qualité (décennie 80) et la
valeur financière (décennie 90). C’est une « continuation –
amplification » du thème de l’éthique des affaires et un acte de
direction générale. Les arguments de ce texte sont les suivants : une
explicitation de la notion de RSE, la question de savoir si la
responsabilité sociale de l’entreprise ne peut être considérée comme
un modèle « anglo-américain », la question de savoir pourquoi on
parle aujourd’hui de RSE et l’examen des critiques qu’il est possible
de lui adresser.
par Yvon Pesqueux
Professeur titulaire de la Chaire
Développement des Systèmes d’Organisation
CNAM, Paris (France) |
ARTICLE 11
Éthique, marché et gouvernance : espace
discrétionnaire et responsabilité sociale des grandes entreprises
Résumé :
L'absence de perfection de la concurrence, l'inefficience des
marchés, introduisent un espace discrétionnaire pour la prise de
décisions au sein des grandes entreprises. Les théories des
incitations, en s'attachant à déterminer les mécanismes susceptibles
de lier l'intérêt des dirigeants à celui de leurs actionnaires, cherchent
à contrôler cet espace discrétionnaire au bénéfice de la maximisation
de la valeur de marché. Une approche orientée vers les parties
prenantes a pour effet de redonner un rôle positif à cet espace
discrétionnaire en l'ouvrant sur le domaine de l'éthique. Aujourd'hui,
cette éthique semble se traduire sous deux aspects complémentaires :
celui de la transparence dans la reddition des comptes, des actes et
des décisions, et celui de la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des
parties prenantes.
par Benoît Pigé
Professeur des Universités
Université de Franche-Comté
(France) |
ARTICLE 12
Les déterminants de la coopération des entreprises vietnamiennes avec des organisations caritatives
Résumé :
Cette recherche étudie les déterminants de l’engagement des
entreprises vietnamiennes dans une coopération avec des
organisations caritatives grâce à l’interview des managers de dix
entreprises travaillant avec le « Fonds de Protection des enfants
Vietnamiens ».
La recherche montre que la philanthropie vietnamienne oscille
entre utilitarisme et altruisme. S’il apparaît que les firmes accordent
de l’importance aux retombées économiques de cet engagement, ce
dernier semble néanmoins largement emprunt de considérations
morales. Cette recherche met en relief l’importance de la
contextualisation dans la compréhension de la responsabilité sociale
et l’influence des variables culturelles sur les comportements
charitables. Parmi ces variables, les valeurs religieuses bouddhistes
semblent essentielles pour comprendre les relations existant entre les
entreprises et les organisations caritatives vietnamiennes.
par Emmanuelle Reynaud
Professeur des Universités
Thi-Nam-Giang Phan
Magalie Marais
IAE, Aix-en-Provence (France) |
ARTICLE 13
Définir et mesurer la fidélité organisationnelle
Résumé :
La fidélisation des salariés présente d’importants enjeux
managériaux dans le contexte actuel de pénurie de talents. De
nombreuses recherches ont eu pour objet d’étudier les leviers d’action
pour favoriser la rétention des salariés en agissant sur l’intention de
départ. D’autres travaux ont porté, au-delà de la fidélisation, sur la
notion de fidélité du salarié à son organisation en incluant d’autres
dimensions que l’absence d’intention de départ. La fidélité
organisationnelle peut être définie à travers cinq dimensions: la faible
propension à rechercher un travail ; l’attachement affectif ;
l’efficacité dans l’exécution des activités (performance dans la
tâche) ; l’altruisme et la conscience professionnelle (contribution à
l’entretien et à l’enrichissement du contexte social et psychologique
de l’organisation). L’objectif de cet article est de définir et de mesurer
la fidélité organisationnelle.
par Jean-Marie Peretti
Professeur des Universités
ESSEC et IAE de Corse
(France)
Abdelaziz Swalhi
IAE de Corse
(France) |
ARTICLE 14
Hypermodernité et développement des ressources humaines : vers de nouvelles aspirations individuelles ?
Résumé :
Cet article vise à poser la question du développement des
ressources humaines dans le cadre d’un contexte émergent : celui de
l’hypermodernité de la société. L’auteur s’interroge sur l’influence
des traits caractéristiques de l’hypermodernité (l’excès, l’urgence,
l’éphémère, la créativité, le dépassement de soi, etc.) qui semble
pénétrer progressivement les organisations et leur mode de
management. Rédigé sur la base de nombreuses lectures mais aussi
d’expérimentations et d’exemples, le texte analyse la posture du DRH
mais aussi des managers d’équipe en tant qu’agents de changement.
Les principaux axes de transformation et de développement
organisationnel sont discutés dans le contexte paradoxal
d’individualisation des outils de GRH d’un coté et de renforcement de
l’organisation du travail en équipe de l’autre.
par Jean-Michel Plane
Professeur des UniversitéS
Université Paul Valéry, Montpellier III, ORHA
(France) |
ARTICLE 15
RSE et santé au travail
Résumé :
Depuis quelques années, le coût de la santé au travail constitue un
thème de préoccupation majeur notamment à cause de l’apparition
des nouvelles pathologies du travail. Le stress et les troubles
psychosociaux en constituent une proportion importante.
Dans cet article, un chiffrage des coûts occasionnés par ces
pathologies est présenté afin de montrer l’enjeu que représente la
santé au travail auprès des entreprises et de la collectivité.
Une démarche préventive devient donc indispensable pour
remédier à cette situation. Au-delà des obligations légales et
réglementaires, cet article démontre dans quelle mesure la
préoccupation volontaire des dirigeants à la promotion de la santé de
leurs salariés constituerait un volet stratégique déterminant de la
Responsabilité Sociale de l’Entreprise.
par Georges Trépo
Professeur
Groupe HEC, Paris
(France)
Olfa El Ajroud-Ayoub
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
(France) |
ARTICLE 16
Le chercheur en gestion est-il audible ?
Résumé :
L’objet de cette communication est de présenter quelques
réflexions sur la relation entre le chercheur et les acteurs concernés
par son champ de recherche, relation élargie à la figure du décideur
politique et envisagée du point de vue des médias susceptibles de s’y
intéresser. Dans une démarche d’approfondissements successifs,
après quelques considérations générales sur la trilogie sujet de
recherche – chercheur – décideur politique selon les secteurs
scientifiques concernés, faisant ressortir les spécificités du secteur des
sciences de l’Homme et de la société (SHS) (I), nous évoquerons, à
l’intérieur de ce vaste secteur des SHS, la situation contrastée de
diverses disciplines, pour nous focaliser sur celle des sciences de
gestion (SG) (II). Enfin, nous présenterons en « Propos d’étape » (III)
quelques observations sur l’évolution des relations entre acteurs et
chercheurs en gestion
par Roland Pérez
Professeur Émérite
Université de Montpellier 1
(France) |
ARTICLE 17
Management stratégique de la diversité : du gadget pour DRH à une nouvelle philosophie du management
Résumé :
Propos d’étape, cet article met en évidence l’importance d’un
approfondissement préalable du concept de diversité avant toute
réflexion praxéologique concernant le domaine très actuel du
Diversity Management. Dans un premier temps, il présente l’évolution
d’une typologie passant d’un constat de diversité (séparation /variété/
disparité) à une prise en compte de l’intensité croissante de cette
diversité (individus /communautés /processus /systèmes). Dans un
deuxième temps, il aborde les questions transversales que sous-tend le
projet de recherche entamé : Toujours plus de diversité ? Que
mesure-t-on ? Pour quoi faire ? En conclusion, il suggère le défi que
constitue pour les managers une globalité de la diversité tantôt subie,
tantôt voulue dans une vision stratégique
par Jacques Lebraty
Professeur Émérite
Université Nice Sophia Antipolis (France)
Lyvie Guéret-Talon
Professeur CERAM
Sophia Antipolis (France) |
ARTICLE 18
Société de la connaissance, université et territoire
Résumé :
L’objet de cet article est de soumettre à la discussion une réflexion
sur la relation entre l’université et le territoire dans le contexte de la
société de la connaissance. Il examine deux facettes de cette relation.
Dans la première, l’université est vue comme un agent dont les
dépenses « impactent » l’économie territoriale. Dans la seconde, elle
est appréhendée comme un acteur capable de projets et qui contribue
au développement d’un territoire. L’article introduit progressivement
des éléments utiles à la compréhension du sujet, liés aux évolutions
induites par l’émergence de la société de la connaissance et à certains
aspects de la gouvernance territoriale.
par Claude Jameux
Professeur des Universités
Université de Savoie, IREGE *
(France) |
ARTICLE 19
Une « Project-Based View » pour le « Strategic Choice »
Résumé :
La théorie du choix stratégique proposée par J. Child est bien
connue pour sa récusation du volontarisme et du déterminisme en
théorie d’organisation. En mettant l’accent sur l’interdépendance
dynamique entre choix et contraintes pour comprendre les
comportements organisationnels, elle présente pour son auteur un fort
potentiel d’intégration des différentes lectures des phénomènes
stratégiques et organisationnels. Partant de cette position, qui sera
discutée, le papier suggère la nécessité de faire une place à l’agir
projectif et au projet dans la construction théorique sur trois
dimensions : paradigmatique sur la question de la rationalité,
conceptuelle sur la notion de projet, et théorique sur la prise en
compte du projet dans l’action collective et les théories de
l’entreprise.
par Jean-Pierre Bréchet
Professeur des Universités
Institut d’Economie et de Management de Nantes
IAE, Université de Nantes (France)
Alain Desreumaux
Professeur des Universités - IAE, Université de Lille
LEM – (France) |
ARTICLE 20
De la difficulté de prévoir la trajectoire
d’un outil de gestion
Résumé :
Malgré les nombreuses connaissances accumulées sur les
organisations et les outils de gestion, il reste très difficile d’anticiper
le devenir de ces derniers à partir du moment où l’on tente de les
implanter dans un fonctionnement organisationnel. Pour illustrer ce
point, l’article décrit l’histoire d’un outil de régulation du système
hospitalier français. Il souligne également comment le suivi d’une
telle trajectoire apporte au chercheur des connaissances inédites sur
l’organisation.
par RJean-Claude Moisdon
Professeur
Ecole des Mines de Paris (France) |
ARTICLE 21
Une firme est une firme : n’est-ce pas ?
Contribution à la méthodologie de recherche en sciences de gestion
Résumé :
Malgré une certaine ouverture au constructivisme des sciences de
gestion, la méthodologie « royale » en sciences de gestion demeure
l’approche fondée sur les principes du positivisme et de l’analyse
statistique de données. Cependant, une limite de cette approche est
qu’en dehors de la prise en compte de la variété pouvant exister dans
des faits stylisés au sens de Kaldor, les analyses sont fondées sur un
raisonnement « toute chose égale par ailleurs ». Cette vision
simplifiée de la réalité conduit à ignorer que la similarité apparente
ne signifie pas l’absence de différences. L’ignorance de ces
différences effectives dans le raisonnement conduit souvent les
organisations à prendre des décisions aux conséquences désastreuses.
Par conséquent, cette contribution propose un renouvellement
méthodologique, fondé sur le raisonnement au cas par cas, au sens de
la « Common Law » anglo-saxonne. Le potentiel scientifique de cette
approche est développé en deux parties ; la seconde partie insistant
en particulier sur les conditions à respecter pour que le caractère
scientifique de cette méthode ne soit pas contesté.
par Jacques Liouville
Professeur des Universités
Université Robert Schuman de Strasbourg
CESAG – Ecole de Management de Strasbourg
(France) |