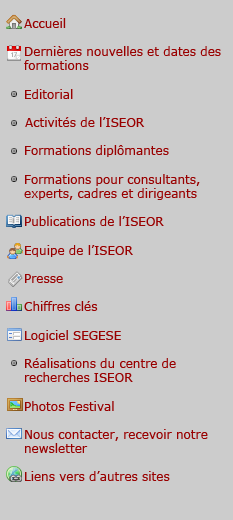ARTICLE 1
Critères de qualité de la relation de service : une proposition de typologie
Résumé :
Cette recherche vise à déterminer des critères de qualité de la
relation de service. Elle s’appuie sur le cas de l’aide à la création
d’entreprise.
Suite à une revue de littérature et à 20 entretiens auprès
d’entrepreneurs sont proposées une typologie des critères théoriques
de qualité de la relation de service, ainsi qu’une déclinaison de cette
typologie adaptée au cas de la relation existant entre conseillers et
créateurs d’entreprise. L’écart entre le point de vue des créateurs et
celui du financeur relativement à cette question de la qualité est mis
en exergue. Des pistes permettant d’utiliser la typologie pour collecter
les perceptions des créateurs sont avancées ; des suggestions pour le
contrôle et la gestion des ressources humaines sont faites.
par Sylvie Rascol-Boutard
Maître de conférences
Université d’Orléans - LCT
Pascale Amans
Maître de conférences
Université Toulouse III - IUT - LGC |
ARTICLE 2
Le risque opérationnel dans les institutions de
microfinance. L’étude du cas d’un réseau de
coopératives de microfinance
Résumé :
Comme phénomène organisationnel, le risque opérationnel est peu
exploré dans les Institutions de microfinance. Partant de ce constat,
cette recherche se donne pour objectif d’identifier ses causes à partir
de l’étude du cas d’un réseau de coopérative de microfinance.
L’analyse des données permet de conclure que le risque opérationnel
résulte de la nature du système de gestion et des déficiences dans
l’architecture organisationnelle des IMF. Les causes sont endogènes
aux caisses et peuvent leur être transmises par le sommet stratégique
du réseau auquel elles appartiennent. La forme organisationnelle
apparait ainsi comme un facteur aggravant du risque opérationnel.
par Hubert Tchakoute Tchuigoua
Professeur
BEM-Bordeaux Management School |
ARTICLE 3
Les PME font-elles de la prospective des RH ?
Résumé :
L’anticipation en GRH n’est pas absente des problématiques
organisationnelles des PME. Si la GRH s’y intéresse encore faut-il
l’identifier dans les PME. Par ailleurs, certains dispositifs
d’anticipation RH ont montré leurs limites : excès d’instrumentation,
désocialisation de l’organisation. Dans ce contexte, à partir de la
notion de dispositif d’anticipation RH, l’objectif de cet article est
d’identifier les principaux dispositifs présents au sein des PME et d’en
comprendre les enjeux.
par Franck Brillet
Directeur adjoint CERMAT (EA2109)
Maître de Conférences, habilité à diriger des recherches
Patricia Coutelle
Maître de Conférences
Annabelle Hulin
Docteur - ATER |
ARTICLE 4
Les entreprises intègrent-elles, dans leurs stratégies, les
aspects de la société par choix ou parce que cela leur
est imposé par l’évolution de l’environnement ?
Résumé :
L’actualité et l’observation montrent que : 1°) la réussite de
l’entreprise ne passe plus simplement par la seule prise en compte
des variables économiques et financières 2°) la Société civile attend,
de plus en plus, de l’entreprise qu’elle soit beaucoup plus
« citoyenne », quelles qu’en soient, par ailleurs, sa taille et sa
nationalité. Autrement dit, indépendamment de son objectif légitime
de faire, avant tout, du profit, la Société civile attend d’elle, qu’elle
prenne, aussi, part au développement du tissu économique de la
région qui l’accueille, participe aux frais de son éducation et de sa
formation, favorise l’emploi local, ne détruise pas l’environnement
qui l’héberge de par son mode de production, et participe enfin, à sa
manière, à la lutte contre les inégalités locales et l’exclusion sociale.
par François Ecoto
Full Professor, ESC Rennes School of Business |
ARTICLE 5
Irrationalité de la décision : une approche
par les préférences
Résumé :
L’irrationalité a toujours manifesté un scepticisme chez les
chercheurs. Cette contestation a été systématisée par les travaux de
Kahneman et Tversky. A partir d’expériences en laboratoire, ces deux
chercheurs ont décrit plusieurs sources d’irrationalité du
comportement humain, en particulier, l’ambiguïté, l’incohérence et
l’instabilité des préférences chez l’individu. En s’appuyant sur ces
travaux, nous cherchons à mieux comprendre la rationalité chez
l’individu décideur. Nous proposons une lecture critique des
modalités de rationalité et expliquons l’irrationalité par la variabilité
des préférences chez l’individu (décideur) en appréhendant leurs
modalités de construction. Nous mettrons l’accent sur l’aspect
« élicitation des préférences » par apprentissage constructif. Nous
soulignerons l’apport de telle approche.
par Saïda Habhab-Rave
Enseignant chercheur
CEREGE / IAE Poitiers |
|