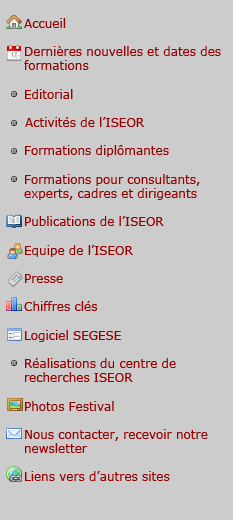ARTICLE 1
La planification au XVIIème siècle : innovation économique et mathématisation de l’univers
Résumé :
Invité à participer à un colloque international organisé par le
Centre d’études et de recherches sur la vie économique des pays
anglo-saxons (CERVEPAS) de l’Université Paris III, ayant pour
thème l’économie de l’innovation dans le monde anglo-saxon, nous
avons choisi pour sujet « La planification au XVIIème siècle :
innovation économique et mathématisation de l’univers ».
Pour nous aider à mieux cerner la signification à donner au terme
d’innovation et à mieux juger de la pertinence de notre sujet nous
avons compulsé plusieurs ouvrages consacrés à l’étude de ce concept.
C’est un livre récent de Pierre Tabatoni intitulé Innovation, désordre,
progrès, qui devait par son approche à la fois synthétique et analytique
nous confirmer l’intérêt de notre problématique en nous permettant de
multiplier les éclairages grâce aux nombreuses perspectives qu’il
offre. Avec la passion qui l’anime, Pierre Tabatoni nous a fait
comprendre toute la portée et toutes les implications du mot
innovation en ne se cantonnant pas au cadre étroit de l’entreprise, mais
en le replaçant dans le contexte de l’économie monde. L’étude du
texte de Tabatoni et de ceux des pamphlétaires économistes du XVII è
siècle nous porte à croire que l’innovation est bien la clé de la
dynamique économique et que selon la formule de Peter Drucker elle
est « l’instrument spécifique de l’entrepreneuriat ».
par Michel Péron
Professeur Emérite1
|
ARTICLE 2
La transition aux normes IFRS des sociétés foncières :
le cas des actifs immobiliers
Résumé :
En 2005, l’entrée en vigueur des normes comptables
internationales entraîne des changements sensibles dans les pratiques
comptables et l’information financière des sociétés cotées établies
dans les pays membres de l’U.E. Dans cet article, nous nous
intéressons plus particulièrement aux cas des sociétés foncières cotées
pour lesquelles la transition aux normes IFRS comporte des enjeux
importants en matière d’évaluation des actifs. A partir de la revue des
rapports annuels 2003 de dix sociétés foncières, notre propos vise ici
à examiner, d’un point de vue normatif et opérationnel, les principales
problématiques du passage aux normes IFRS concernant les actifs
immobiliers.
par Eric Tort
Expert-comptable certifié IFRS
Docteur en sciences de gestion
(GREGOR - IAE de PARIS) |
ARTICLE 3
Performances boursières et conflits d’intérêts
suite à l’introduction en Bourse : le cas français
Résumé :
Notre étude porte sur l’évolution de la performance boursière trois
ans après l’introduction des sociétés au marché parisien entre 1991 et
1998. Nous supposons que l’existence de conflits d’intérêts entre
actionnaires et dirigeants ou entre actionnaires de contrôle et
actionnaires minoritaires influence la performance après
l’introduction.
Par Laurence Godard
Maître de Conférences, Université de Franche-Comté
LEG/FARGO (Dijon)
Dominique Poincelot
Maître de Conférences, Université de Franche-Comté
CUREGE
|
ARTICLE 4
Les erreurs de prévision de bénéfices :
le cas des introductions en bourse en France
Résumé :
Nous étudions les erreurs de prévision de bénéfices publiés dans
les prospectus de 151 entreprises françaises introduites en bourse
entre 1996 et 2000. Nous trouvons, d'une part, que les entreprises
françaises font globalement preuve d'une certaine prudence, d'autre
part, que les erreurs de prévision dépendent de la fraction d'actions
conservées par les actionnaires d'origine après l'opération.
par Alain Schatt
Professeur
Université Robert Schuman, Strasbourg
LEG/FARGO (Dijon) |
ARTICLE 5
Emergence des normes de gouvernance :
une analyse sociologique du cas français
Résumé :
Les normes de gouvernance, mises en exergue dans le contexte de
globalisation actuel, méritaient d’être étudiées au regard du
processus présidant à leur émergence. Cette recherche, de nature
exploratoire, se caractérise par une approche transdisciplinaire tant
au point de vue conceptuel que méthodologique. Une étude des
fondements sociologiques de la norme permet d’expliciter au regard
de la théorie positive de l’agence, le processus d’élaboration de la
norme de gouvernance, et l’impact cognitif d’une application de celleci
sur la performance perçue. De plus, une étude qualitative du
rapport Clément, consacrée à la réforme française du droit des
sociétés, illustre l’influence dominante exercée par les lobbies
patronaux sur les régulateurs. L'approche quantitative montre, quant
à elle, comment l’effet cognitif d’une application de la norme de
gouvernance peut influer sur l’arbitrage des investisseurs.
par Céline Chatelin-Ertur
Maître de conférences
IAE d’Orléans (LOG)
Stéphane Trébucq
Maître de conférences
Université Montesquieu Bordeaux IV
IAE de Bordeaux (CRECCI) |
|